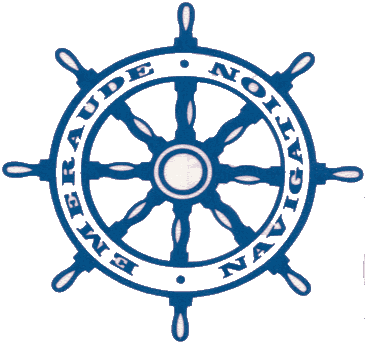Articles
de Marie Gautier
Canal
à la Une
En bord de garonne,
Couthures, un village les pieds dans l'eau
Les Mousquetaires
de la Baïse
Ponton flambant neuf
à Langoiran
Traversée
de la France en péniche
Monument majeur sur
le Lot
Terres de rivières
Bonheur en Vallée
du Lot
Sur
le canal du Midi, l'association "Canal à la
Une"
Reliant l'Atlantique
et la Méditerranée, le canal des Deux-Mers, qui englobe
le canal du Midi et le canal de Garonne, se redynamise.
En 1997 - un an après l'inscription du canal du Midi au
patrimoine de l'UNESCO -, Sylvie Robin,
soucieuse de sauvegarder la mémoire de cette voie d'eau,
fondait avec trois amies de la région toulousaine l'association
Canal à la Une. Laquelle ouvrait aussitôt un pôle d'information
près de l'abbatiale Saint-Pierre, avant d'installer une
antenne girondine à Castets-en-Dorthe, la porte atlantique
du canal, et de changer de département après
la démission de sa présidente fondatrice.
Marie Gautier Présidente adjointe a écrit
l'article contenu dans le Chasse-marée cidessous,
développe la voie d'eau notamment sur la Baïse
et en Pays d'Albret où se trouve actuellement les
différentes expositions de l'association.

L'association
organisait régulièrement des manifestations dans des lieux
évocateurs - notamment sur la gabare Val de Garonne
ou la péniche Zambézi -, des expositions
sur l'histoire du canal des Deux-Mers, ainsi que des conférences
et des spectacles à l'intention des scolaires et des estivants.
Plusieurs peintres, dont Yves Donval, ainsi que l'ancienne
éclusière Bernadette Miquel (aujourd'hui décédée) ont
ainsi apporté leur contribution à ces événements. Documents
interactifs de qualité, tables rondes animées par des
spécialistes - joliment baptiseés "les
éveilleurs de mémoire" -, illustrent le thème et permettent
de recueillir le témoignage des anciens. Des liens de
confiance ont également été noués avec les élus et les
institutions, comme Voies
navigables de France, structure en charge de la gestion
et de l'entretien du canal. En trois ans, l'association
s'est ainsi dotée d'une banque de données livresques et
photographiques incontournable. Consulté mensuellement
par dix mille internautes son site Internet lui permet
de trouver des partenaires pour valoriser le potentiel
touristique du canal, tel Michel Dusseau le plus jeune
chef "toqué" de la restauration française.
Pierre-Paul
Riquet de Bonrepos, le génial constructeur du canal
du Midi, avait pour maxime : "Il faut finir l'ouvrage
ou mourir à la peine". La maraude l'a cueilli trop tôt
pour qu'il voie l'achèvement de son oeuvre. Il peut en
revanche reposer en paix : avec cette association, qui
vient cette année de créer deux emplois, le patrimoine
du canal sera bien protégéé !
article
paru dans le Chasse-Marée n°144
de juillet 2001
En
bord de Garonne, un village les pieds dans l’eau
En Aquitaine, plusieurs petits villages
portent le nom de Couthures.
Les Romains ont laissé des traces dans cette ancienne
province et quelle qu'en soit l'orthographe, il s'agit
toujours d'un terroir agricole.
Ce qui est moins banal, c'est que "notre" Couthures
se blottit presque intégralement dans un méandre
de la Garonne, sur une de ces bassures en étroite
communion avec l'élément liquide. Mais n'allez
surtout pas évoquer la présence du fleuve
en mentionnant son article au féminin, vous seriez
immédiatement repéré comme un gavache
ou un Parisien ne connaissant rien aux usages! Car ici,
les gars du coin vont "à Garonne" et
entretiennent avec cette Dame une relation fusionnelle.
D'ailleurs, s'ils acceptent de s'en partager les faveurs,
ils trouveraient déplacé que des femmes
s'approchent de trop près de leur territoire intime.
C'est que Garonne fait de vous un homme, trois fois par
siècle en moyenne, lorsque l'agat envahit le village,
à partir des 9 mètres étalonnés
sur l'échelle des crues, et s'invite alors dans
les maisons. Certains attendent donc la trentaine avant
d'être ainsi initiés et de pouvoir à
leur tour transmettre la légende.
En cadeau d'adieu, le précédent maire est
allé rechercher dans les archives agenaises ce
qui restait de l'histoire humide du village, car sur place,
les vieux écrits avaient fini par être définitivement
noyés. La mémoire collective en a donc été
rafraîchie. Les Couthurains ont ainsi redécouvert
qu'au XIXe siècle, leur colérique divinité
avait rasé la moitié des habitations; et
chacun frissonne encore au souvenir des tombes qu'elle
profana en 1930.
Et pourtant, lorsque Garonne fait des siennes, les quatre
cents habitants de Couthures célèbrent l'événement.
Les générations précédentes,
qui avaient plus de patois au bout des lèvres,
les anciens résument ses frasques de la journée.
J'en connais qui ne se lassent pas de contempler la palette
changeante des eaux: "Aujourd'hui, c'est le Tarn
qui donne", car la Belle revêt une robe sanglante.
Garonne sait aussi être douce, lorsqu'elle dépose
sur les quais une lise de laess offert par le vent. Chacun
tend l'oreille pour écouter son chant modulé
par la variation incessante de ses courants de fond et
sourit en pensant aux Périgourdins impressionnés
par les caprices pourtant bien plus sages de leur Dordogne.
Garonna (en patois) sait imposer le respect en grossissant
de 4 mètres en l'espace de vingt quatre heures,
justifiant alors l'origine de sa source, située
dans les Pyrénées ibériques, au Mont-Maudit.
Le spectacle est impressionnant et très typique
de ce lieu. S'enroulant d'une berge à l'autre,
le fleuve dessine une immense spirale, la rémeille,
ramenant sur le bord des troncs d'arbres vite amarrés.
Depuis toujours, ce cadeau naturel fournit le bois de
chauffage. Il procurait naguère un modeste revenu
à ce peuple de tireurs de corde, car cinquante
hommes n'étaient pas de trop pour haler les gabares
à la remonte lorsqu'elles passaient devant Couthures.
La profondeur y est importante et les courants violents.
Qu'elles soient civiles ou religieuses, les fêtes
du village cimentent son identité. A chaque occasion,
les sauveteurs animent les joutes nautiques, et Garonne
nourrit l'imaginaire de ses riverains. En 1999, c'est
l'évêque d'Agen qui l'a bénie du bord
d'une embarcation, après avoir célébré
sa messe sur la pile de l'ancien pont, dont on se remémore
douloureusement la destruction à chaque réunion.
Emblème de Couthures, celui-ci a contribué
à sa prospérité au XIX siècle,
car on y payait très officiellement son passage.
Un "droit" nettement plus suspect consistait
à prélever son octroi sur les bateaux naviguant
sur le fleuve, d'où découle une solide réputation
de pilleurs d'épaves.
Les
derniers calfats
Jadis, Couthures a regroupé jusqu'à une
trentaine de charpentiers spécialisés dans
la construction et le calfatage des bateaux.
Les derniers du genre - qui avaient conservé le
nom de calfats - se nommaient Boissy, Cassagneau, Denaules,
dit le Brestois, Miramont, Gajac, Jérome et Léon
Roy. Ils travaillaient en bordure du canal sur un chantier
situé à Tersac, qui a cessé toute
activité dans les années 1930, face à
la concurrence de la construction métallique. La
plupart des barques en bois encore en service aujourd'hui
ont été construites par le charron du village
ou par les utilisateurs eux-mêmes, pêcheurs,
chasseurs ou autres prévoyants soucieux de pouvoir
se déplacer lors des inondations.
Jusque dans les années 1950, les particuliers construisaient
souvent leurs bateaux avec du bois flotté, lorsque
Garonne billonnait (charriait) des ragagnous, et mis à
sécher de longs mois avant utilisation. Les professionnels,
quant à eux, recouraient plutôt aux essences
locales: le pin des Landes, ou à défaut
le peuplier, pour le pontil (sole) et les bordés;
le robinier (faux acacia), l'ormeau ou le chêne
de talus, de fil, pour les courbes. Plus récemment,
le sapin rouge de Norvège s'est substitué
au peuplier. Une fois achevées, les coques étaient
passées au coaltar, au brai ou au carbonyle. Depuis
quelques années, l'acier, l'aluminium et le polyester
ont remplacé le bois.
Le
coularin
Appelé gabarot à Castets-enDorthe, canot
en aval, jusqu'à Cadillac, le coularin est le bateau
typique de Couthures. Il semble que le terme dérive
de l'emploi d'une grosse épuisette, le coul, utilisée
pour la pêche aux aloses.
Le coularin mesure entre 5 et 7,50 mètres de longueur
sur 1,10 mètre de largeur. La sole, qui dépasse
légèrement le bordé au niveau du
bouchain, est recouverte d'un plancher en trois parties,
le tilbiac. L'avant, relevé en besogne, se rétrécit
en une petite marotte en forme d'écusson. Moins
cintré que l'avant, l'arrière forme également
une levée. Pesant environ 300 kilos, un coularin
ne s'enfonce guère de plus de 10 centimètres
dans l'eau, ce qui est bien commode sur un fleuve réputé
pour ses maigres en période d'étiage.
Quand la profondeur le permet, le coularin se propulse
et se dirige de l'arrière à l'aide. d'un
aviron de godille. Des gaffes et une perche ferrée
en châtaignier, la bergade, complètent l'armement
pour remonter le courant. Le coularin est ordinairement
monté par trois hommes, un à la propulsion
et les autres aux filets. A partir de 1920, certains ont
été équipés de motogodilles.
Quarante ans plus tard, les moteurs hors-bord proprement
dits sont apparus.
Aujourd'hui, ces engins possèdent généralement
une puissance comprise entre 25 et 60 chevaux, les plus
forts ayant la faveur des sauveteurs, qui doivent rester
opérationnels en période de crue.
Modernisé, le coulatin est toujours utilisé
pour la pêche. Robert François reste le dernier
à avoir pratiqué la volante, technique à
la mouche exercée à bord de son coularin,
à la remonte comme à la descente, la canne
dans une main et l'aviron dans l'autre. Un vrai sport!
Bien sûr, ce bateau, emblème du village,
est toujours présent dans les fêtes et durant
les inondations. Mais on s'en sert é e ment pour
la chasse au gibier d'eau. A Couthures, aujourd'hui, bien
des conversations s'alimentent des "persécutions
d'une Europe qui ne comprend rien aux traditionnelles
chasses aux canards migrateurs". Lesquelles se pratiquent
au lever du soleil à partir d'une tonne, une plate
cabanée amarrée à la berge et camouflée
par de la fougère.
Yoles
et barques en double
Embarcations de plaisance, aux formes effilées
et marines, de tailles diverses - les plus grandes mesurent
7 mètres de longueur -, les yoles sont encore nombreuses
à Couthures. Dans les années 1930, les trois
plus belles yoles de Couthures rivalisaient avec celles
de Villeneuve-sur-Lot ou de La Réole, une cité
située une vingtaine de kilomètres en aval.
Chacune était manœuvrée par quatre
rameurs et un barreur. Certaines gréaient une petite
voile. L'Aviron marmandais a repris la tradition des régates
avec ces embarcations ainsi que les yoles bordelaises
et celles de l'estuaire.
Après la dernière guerre, de nouveaux types
d'embarcations sont apparus à Couthures. Parmi
celles construites par les amateurs, d'inspiration, de
formes et de dimensions variées, mais parfois très
élégantes, on retiendra les barques dites
de Saint-Etienne. Achetés à la célèbre
Manufacture d'armes et cycles, les premiers de ces bateaux
arrivés à Couthures ont par la suite été
copiés et construits à plusieurs unités.
Ils semblent avoir complètement disparu au profit
des barques en polyester.
Le plus curieux de ces petits bateaux est la barque double,
petit catamaran à l'usage des pêcheurs et
des chasseurs, souvent construit par eux-mêmes.
Si certains Marmandais se souviennent en avoir vu une
trentaine amarrées au pont de la cité, il
semble que l'unité retrouvée à Couthures
soit la dernière du genre. Elle se compose de deux
coques de 3,50 mètres de longueur sur 0,60 mètre
de largeur, pointues des deux bouts, espacées d'une
trentaine de centimètres et réunies par
deux légères poutres en bois. L'ensemble
pèse une centaine de kilos. L'écartement
des deux flotteurs permet à l'utilisateur de se
maintenir debout, un pied dans chaque coque, bénéficiant
ainsi d'une stabilité optimale pour la propulsion
à la pagaie - dans un sens ou dans l'autre -, ou
pour pratiquer son loisir confortablement installé.
Ces singulières embarcations du genre périssoire,
qualifiées de négue can (noie le chien),
servaient aussi d'annexes aux tonnes de chasse pour récupérer
le gibier tombé à l'eau.
Au
rythme des migrations
Dans les années 1970, un seul pescaïre, Michel
Gautier, vivait encore de la pêche à Couthures.
A l'époque, sur la commune voisine, l'une des dernières
frayères d'Europe pour les créacs (esturgeons)
et les aloses venait d'être détruite; la
pollution accélérait le déclin du
potentiel de pêche, et l'écosystème
était ravagé par d'intenses dragages.
Démoralisé, Michel Gautier fera tout pour
décourager ses deux fils de continuer le métier.
"Ils avaient déchiré, défiguré
Garonne", s'insurge-t-il. Vingt ans plus tard, sa
colère et sa souffrance sont encore vives.
Alors, pour accroître son rendement, il a dû
moderniser son matériel.
Les anciennes bourgnes (nasses pour les lamproies, lamproyons
et anguilles) qu'il fabriquait durant l'hiver ne sont
plus en vîme (osier), coupé au bord du fleuve,
mais en plastique et en métal. Et depuis une dizaine
d'années, son traditionnel coularin a été
remplacé par une barque en aluminium, construite
dans la commune. Ne pouvant abandonner l'activité
de toute une vie, le jeune retraité, toujours accompagné
de son setter, passe encore ses journées sur son
bateau à relever ses bourgnes, à chasser
le canard ou à surveiller son viral.
C'est le dernier pêcheur à utiliser ce curieux
engin qui recueille tout seul les aloses et les lamproyons
par trois mètres de fond. Du genre masculin ou
féminin, le virol est encore appelé birol
sur d'autres cours d'eau du Sud-Ouest, ou bans sur le
bassin de l'Adour (CM 110). Celui de Michel Gautier est
monté sur une grande plate de 7,50 mètres
de longueur sur 2 mètres de largeur, pesant 400
kilos (à Couthures, l'ensemble du bateau et de
l'appareil porte le même nom).
Le virol est constitué de deux filets en forme
d'entonnoir, placés tête-bêche sur
un axe rotatif en acier, lui-même coulissant en
hauteur le long d'une guillotine. Les eaux volantes (fort
courant) entraînent la rotation des cadres des filets,
qui se comportent comme des pales de moulin. Le poisson
capturé sort automatiquement du piège pour
tomber dans une caisse, que le pêcheur se contente
de vider une fois dans la journée.
Les fils de Michel Gautier avaient suivi le conseil de
leur père. Au début de leur vie professionnelle,
Philippe et Sébastien s'étaient orientés
vers d'autres activités artisanales. Mais c'était
sans compter avec la vocation familiale!
Et puis, suite à l'arrêt des extractions,
le fleuve est redevenu propre et poissonneux; désormais,
nul n'hésite plus à s'y baigner. Aussi,
depuis trois ans, les fils ont-ils repris l'activité
paternelle; ils envisagent même de créer
un emploi à terre.
Ils arment aujourd'hui deux plates en aluminium et ont
étendu leur territoire de pêche en louant
une seconde concession en Garonne et sur la Dordogne.
Leur fief traverse ainsi le département, sans les
affluents. Tout en conservant les techniques transmises
par leur père, leur formation leur donne le recul
nécessaire pour envisager d'inévitables
mutations, en particulier dans le domaine de la commercialisation,
en conjuguant tradition et modernité.
Les espèces migratrices - aloses, lamproies et
anguilles - sont toujours vendues en frais dans leur pêcherie
ou sur les marchés locaux et étrangers (Espagne
et Portugal principalement), mais un nouveau conditionnement,
avec écaillage et filetage, est mis en place. Et
les deux frères se préoccupent de créer
un label "Saveurs de Garonne", du nom de leur
entreprise.
D'autre part, pour parer aux creux saisonniers des espèces
les plus recherchées, les poissons sédentaires
- silure, cabot, mule, gardon et barbot (le plus goûteux)
- jusque-là négligés seront cuisinés
à l'ancienne.
La recherche porte sur une valorisation des produits à
travers une présentation soignée. En l'occurrence,
les impératifs des normes européennes ont
dynamisé l'entreprise en l'incitant à construire
dès le début une chambre de stockage. Et
une unité de transformation est actuellement à
l'étude.
Où
sont les marins?
La Garonne a donc un avenir, mais celui-ci repose sur
un passé qu'il faut se garder d'oublier. Il est
temps de sauver de l'oubli le patrimoine fluvial de la
moyenne Garonne. Il faut en particulier collecter les
dernières embarcations traditionnelles en voie
de disparition.
D'autant que, selon Yan Laborie, conservateur du musée
de la Batellerie de Bergerac, aucun travail en profondeur
sur le sujet n'a jusque-là été entrepris.
On rêve aussi d'un renouveau de la navigation. En
dehors des pêcheurs habituels, celle-ci se limite
aujourd'hui à la descente inopinée de quelques
"radeleurs" en goguette venus de Marmande ou
de Toulouse. En été, il est rare de voir
passer un bateau. Bien sûr, le fleuve n'est plus
entretenu depuis que le canal et la voie ferrée
l'ont supplanté, au XIXéme siècle.
Mais n'est-il pas regrettable que cette voie d'eau ne
serve plus désormais qu'à faire des ricochets?
Puissent un jour de séduisants mariniers s'échapper
des albums d'Hugo Pratt pour venir redonner vie à
la Grande Dame! ?
Remerciements: Jean Constans,
Robert François, Laurence Gagneyre, famille Gautier,
André Belloc, Jean-Claude et Jean-Michel Moreau.
De Marie Gautier,
chasse-marée N°150
Les
mousquetaires de la Baïse,
entretien reccueilli par Marie Gautier auprès de
Alain Thoueilles
Ils étaient trois pionniers attachés à
cette rivière fragile : un ancien batelier, un
marquis et un ingénieur. Le développement
du tourisme fluvial sur la Baïse doit beaucoup à
ces trois Gascons. Alain Thoueilles, seul survivant de
la triade, nous a reçus pour évoquer les
riches heures de la Baïse.
TEXTE : Marie. GAUTIER
sur fluvial novembre 2002
Marie Gauthier
: Peut-on parler de renouveau de la navigation
sur la Baïse ou d'un aménagement ex-nihilo
?
Alain
Thoueilles : Il s'agit bien redémarrage
de l'utilisation de ce cours d'eau puisqu'en dépit
d'un dépit d’un écoulement incertain,
des archives du XIIIe évoquaient un faible trafic.
La canalisation de la « Bayze » est longtemps
restée embryonnaire, son aménagement a progressé
par étapes pour aboutir à un trafic de marchandises
culminant en 1880 avec plus de 130 000 tonnes, transitant
dans le port de rupture de charges de Lavardac.
M. G.:
Vous avez donc « hérité » d’une
rivière déjà aménagée?
A.T : Tout à
fait. Il semble que, dès le VIe siècle,
la Baïse ait été utilisée. Nous
savons qu'au XIIIe siècle, il fallait franchir
les passelis à l'extrémité de la
chaussée des moulins à eaux, au milieu de
forts courants.
Pour vous figurer ce que représentait le passage
de ces pertuis, vous pouvez lire « Jean Tambour
» de Hiette et Aillery.
C'est Sully qui fit aménager les premières
écluses grâce aux plans de Léonard
de Vinci. L’amont de l'ouvrage d'art était
constitué de poutrelles superposées dans
une cane (gorge), à enlever puis à replacer
une à une. Il fallait être gros bras pour
les manier. Chaque sassement nécessitait une demi-journée.
Les portes avales possédaient les premières
vantelles. La rivière sauvage fut canalisée
jusqu'à Condom sous la Monarchie de juillet.
Les travaux effectués sous le mandat du baron Haussmann,
jeune sous-préfet à Nérac en 1835,
ont permis de rallonger et de maçonner les écluses
existantes. La navigation ne durait que deux mois en saisons
froides. C'est à cette époque que l'aménagement
de la haute Baïse, entre Condom et Saint-Jean-Poutge
a permis de désenclaver le Pays d'Albret. Le mince
filet d'eau issu du plateau de Lannemezan ressemblait
en été à un oued.
En 1862, la canalisation d'une rivière pyrénéenne,
la Neste, a permis à 17 rivières déficitaires,
dont la Baïse, d'être soutenues à l'étiage.
La jonction avec le canal latéral, à Buzet
a été inaugurée en 1850, grâce
à un magnifique pont-canal et à une écluse
de descente. Cette ouverture vers « les deux mers
» a assuré au XIXe et au XXe siècle,
la prospérité du port de Lavardac, à
une quinzaine de km en aval de cette confluence artificielle.
En 1880, le trafic culminait avec 13 000 tonnes de marchandises
au pont de Bordes, résultat impressionnant pour
ce cours d'eau encaissé et paisible bien supérieur
à son voisin le Lot, sur l'autre rive de la Garonne.
M. G.: Existait-il
des bateaux typiques de la Baïse ?
A.T.: Non, pas
forcément. On trouve des tailles de bateaux adaptées
au tronçon. En amont de Lavardac, le fond manquait,
les écluses limitaient les bateaux de charge (28,20
m x 4,30 m). Les embarcations étaient de faible
capacité : entre 25 et 75 tonnes, à fond
plat. Les documents du XIXe siècle évoquent
la présence de barques : coutrillons, macalets,
gabarots à proue et poupes plates permettant de
prendre appui sur les rives de cet étroit cours
d'eau lors des retournements.
Ces embarcations naviguaient en convois. Chaque «
mâture » comprenait 3 unités qui se
laissaient « riber » au fil de l'eau sous
la protection de Sainte-Catherine d'Alexandrie. J.-B.
Truaut en compte une trentaine escalant au pont de Bordes,
ce qui est considérable ! L’apport des eaux
de la Gélise permettait à des embarcations
de 100 tonnes d'atteindre Lavardac.
À partir de Vianne, des bateaux de 150 tonnes empruntaient
les écluses identiques à celles du canal
latéral à la Garonne à 31 mètres.
Des sapines, sapinettes, coureaux et des barques pontées
reliaient le Pays d'Albret à Bordeaux ou à
Sète, relayés à partir du 12 mai
1879 par des bateaux à vapeurs.
Le Gentil Latouche reste dans les mémoires avec
ses moteurs de 40 CV tandis que deux percherons ralliaient
Lavardac à Bordeaux en 4 jours à la tire.
Mais la Baïse est passée à côté
de l'essor du trafic sur le canal latéral puisque
c'est très tardivement que les écluses sont
passées à 40 mètres pour les péniches
au gabarit Freycinet de 250 tonnes. Elles n’auraient
pu emprunter ce cours d'eau sans rallonger les sas du
Pays d'Albret.
M. G.:
Quelles sont les raisons du déclin de cette rivière.
Pour quelles raisons le trafic s'est-il arrêté
?
A.T.: Il y a plusieurs
causes à cet abandon de la voie d'eau: l'essentiel
des denrées de l'Albret portait sur la farine minot
et l'Armagnac. En 1870, la fin de l'exclusif ouvre les
colonies aux farines étrangères plus compétitives.
En août 1876, le phylloxéra anéantit
le vignoble ; à partir de 1880, l'ouverture de
la ligne de chemin de fer Port-Sainte-Marie à Condom
étrangle jusqu'en 1914 le transport fluvial. Les
péniches basées à Lavardac ont cessé
leur activité en 1950.
Désespéré de ne plus trouver de travail,
Auguste Placine, le dernier batelier, a méthodiquement
déchiré son bateau. En amont de Lavardac,
la Baïse a été radiée en 1952,
puis déclassée le 14 juillet 1964.
M. G.:
À l'origine, votre fonction à la DDE ne
consistait pas à vous préoccuper de l'aménagement
de la Baïse. Pourtant votre carrière est restée
liée à son destin. Qu'espériez-vous
pour cette rivière?
A. T.: En dehors
de Guy de Blessebois sur ses vedettes, plus personne ne
naviguait sur la Baïse. Le manque d'entretien multipliait
les embâcles et les atterrissements, les berges
étaient affaissées par endroits. Je rêvais
d'une gestion intégrée qui valorise le patrimoine
paysager et son écologie. Il fallait des techniques
douces pour l'entretien à venir : une revégétalisation
de ses berges. La surveillance devait permettre d'assurer
le débit et la qualité hydraulique en abordant
globalement les besoins des utilisateurs de ce bassin-versant:
collectivités, professionnels (l'agriculture étant
prioritaire sur le tourisme fluvial lors des pénuries),
propriétaires riverains très concernés
par les affaissements de terrains ainsi que les pêcheurs.
Il fallait se donner les moyens logistiques et assurer
la formation d'une profession nouvelle dans notre département
: celle de technicien de rivière et faire naître
l'envie de naviguer sur la Baïse.
M. G.:
Quelles ont été les étapes de la
remise en navigation du cours d'eau?
A. T.: La
DDE a financé l'achat du DieuDonné (dont
plusieurs lettres reconnaissantes reprennent le sigle
DDE). Il tractait une pelleteuse embarquée sur
une barge pour recalibrer et nettoyer la Baïse à
partir des années 70. Les écluses fuyaient
ou avaient leur ventellerie en piteux état, les
chaussées étaient abîmées.
De 1977 à 87, l'aménagement hydraulique
portant sur la régulation des crues a exigé
de lourds travaux en partenariat avec le syndicat intercommunal
d'aménagement hydraulique de la Baise. Le lycée
agricole de Nérac a accueilli les apprentis en
génie végétal, formation que j'ai
créée et que j'assure toujours, bien que
retraité de fraîche date. Un travail de fond
a permis de sensibiliser les autorités au potentiel
touristique de cette voie d'eau. Dans les années
70, il fallait un palliatif à la crise de débouchés
agricoles. La saturation du canal du Midi a été
un atout pour décider Jean François Poncet,
le président du Conseil Général et
le CDT à regarder la modeste Baise de plus près.
Plusieurs hommes ont forcé le destin mais c'est
surtout Guy de Blessebois, aubergiste sur les rives de
la Baïse et pêcheur invétéré
(d'où le nom de son restaurant à Feugarolles:
la Sandrerie) ainsi qu'un ancien batelier : Roger Larrose
qui m'ont épaulé dans cette aventure. On
doit à ce dernier une collecte de précieux
renseignements sur la batellerie lavardacaise du XIXe
et XXe siècle.
M. G.: Le
tourisme fluvial est donc né de beaucoup d'amitié?
A. T.: C'est
certain. Des loueurs de bateaux tels que Aquitaine Navigation,
Crown Blue Line ou Locaboat, ainsi que le bateau à
passagers Prince Henri, basé à Nérac,
nous ont aidés à sensibiliser le grand public.
Ils connaissaient l'impact de ce type de développement
en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Ils voyaient
la saturation du canal du Midi car ils étaient
installés sur son prolongement le canal latéral
à la Garonne, et percevaient la nécessité
de diversifier l'offre de navigation par des rivières.
I'ouverture de la Baïse était pour nous la
première étape avant celle du Lot et pourquoi
pas, de la Garonne déclassée en 1972 en
amont de sa confluence avec la Baïse.
M. G.:
À quel moment avez-vous pensé que votre
pari était gagné?
A. T.: Cela,
c'est fait par étapes. En 1980, le Ministère
de l'Équipement remettait en service l'écluse
de Buzet sur Baïse. Cinq ans plus tard, le bief était
réhabilité jusqu'à Vianne. Le tronçon
a été inauguré par un dragueur du
canal le Simoun et l'Escale un bateau à passagers.
Ce moment reste gravé dans ma mémoire parce
qu'il a concrétisé 30 ans de démarches,
d'espoir et de désespoir. L'ouverture officielle
à la navigation a eu lieu en 1987 avec 180 passages
de bateaux. En juin 1989, nous avons organisé les
« journées de l'environnement » à
Feugarolles, Vianne et Lavardac. Des loueurs de bateaux
ont initié le public sur un court tronçon
sur un bief réhabilité. En 1993, les plaisanciers
pouvaient atteindre Nérac, Moncrabeau en 1994,
Valence-surBaïse en 1996, Condom en 1998. Actuellement,
l'aménagement des 84• km de Baïse permet
d'atteindre l'abbaye de Flaran, à Saint-Jean Poutge,
Il est entré en synergie avec le Lot qui sera sous
peu navigable jusqu'à l'abbaye de Conques.
M. G.:
À l'heure des bilans, que ressentez-vous ?
A. T.:
Je suis un homme comblé professionnellement. J'ai
passé le flambeau à mon fils Laurent qui,
à son tour, travaille au service de la navigation
de la DDÉ. Le brevet de technicien de rivière
a fait des émules dans d'autres régions
françaises, le nombre de navigants s'accroît
chaque année, on en dénombrait 2 400 en
2001 à la double écluse de descente en Baise.
Les retombées économiques sont pleines d'espoir
pour le département. ?
Langoiran,
Un ponton flambant neuf :
La tempête de décembre 1999
avait Langoiran en bordure de Garonne. Le 22 septembre,
le président du SIVOM de Langoiran-Le Tourne, Jean-Louis
Lameu-Manan, maire du Tourne, inaugurait un appontement
heuf qui aura coûté 477000 F La présence
de nombreux ' officiels symbolisait une réelle
volonté de développement du domaine fluvial
girondin. Tandis que la députée Odette Trupin
évoquait la renaissance du transport fluvial de
pondéreux, le maire de Langoiran, Raoul Orsoni
annonçait la création d'une base nautique..
Bègles, Cadillac, Combes, Ças et-en-Doithe,
s'équipent à leur tour pour accueillir un
nombre croissant de plaisanciers sur la Garonne.
Article de Marie Gautier, Fluvial Décembre 2001
– Janvier 2002
La
France traversée en péniche
Aujourd'hui âgé de vingt-six
ans, Paul Pinquet - surnommé P'tit Paul - est l'héritier
d'une longue lignée de mariniers en exercice depuis
1830. Après avoir obtenu son BEP d'électrotechnicien
et servi sous les drapeaux comme mécanicien, il
navigue durant six ans sur la Garonne et son canal latéral
à bord de son propre bateau, la Babette. Il se
met alors en quête d'une unité plus récente,
ce qui le mène à Conflans-Sainte-Honorine,
où il retrouve une fraternité batelière
en voie de disparition en Aquitaine. Car la Babette est
le seul rescapé des trois cent cinquante bateaux
qui sillonnaient encore la Garonne voici une vingtaine
d'années.
L'acquisition de l'Europa donne à Paul Pinquet
l'occasion de sortir du champ étroit des voies
d'eau du Sud-Ouest. Il travaille ainsi quelque temps sur
le réseau Seine-Nord, avec sa femme Rose-Marie
et son jeune fils, Guillaume. Cependant, le mal du pays
gagne bientôt la famille. Pourquoi ne pas exploiter
la nouvelle péniche sur le canal des Deux-Mers
? Cherchant un fret pour financer ce long voyage, Paul
Pinquet trouve à Compiègne un chargement
de silicate de soude destiné à Lyon.
Ainsi, en février dernier, la péniche Europa
largue-t-elle les amarres pour une traversée de
l'Hexagone par le tortueux réseau des voies d'eau
intérieures. Elle emprunte d'abord plusieurs canaux
reliant l'Aisne et la Marne à la Saône. Cette
dernière a une faible déclivité et
sa partie canalisée ne compte que cinq écluses.
La Saône est réputée pour sa lenteur,
mais les pluies de plusieurs semaines ont grossi le fleuve,
dont le débit approche les 2 000 mètres
cubes/seconde. Son fret déchargé à
Lyon, l'Europa dévale le Rhône à 25
kilomètres à l'heure, .jusqu'à Arles.
Ses patrons forment des vaux pour ne pas endommager les
deux gouvernails avec des débris flottants, pour
franchir sans encombre les écluses géantes,
et pour s'amarrer en lieu sûr avant la nuit.
En aval d'Arles, le canal Lamour, du Rhône à
Sète, se révèle bien étroit
pour l'intensité de son trafic. Ce chemin d'eau
traverse paisiblement de nombreux étangs où
viennent hiverner des . colonies de flamants roses. Puis
la péniche pénètre dans le canal
du Midi par l'étang de Thau.
C'est après Béziers que ce périple
prend un tour vraiment original. La mise aux normes du
gabarit Freycinet (38,50 mètres)' n'ayant pas été
réalisée sur le canal du Midi, l'Europa
est trop longue pour entrer dans le sas des écluses,
limité à 30 mètres. Un ascenseur
à bateaux permet d'éviter les sept écluses
de Fonsérannes.
Ensuite, les Pinquet doivent s'arrêter trois jours
dans un chantier pour... couper leur péniche en
deux par le travers. Ce travail, qui comprend la pose
préalable de deux cloisons étanches, est
assuré par André Ribo, habituellement employé
à Toulouse par la batellerie à passagers.
Une fois la péniche tronçonnée, il
faut doubler l'équipage, les propriétaires
ne pouvant assurer la manoeuvre de deux moitiés
de bateau. Deux copains viennent donner la main pour déhaler
la partie avant lors des sassements. Le tirant d'air de
la péniche pose également problème
au passage de certains ponts. Il faut alors ballaster
l'Europa en remplissant d'eau des cuves transportées
dans ce but Enfin, à RamonvilleSaint-Agne, une
fois franchis tous les obstacles, les deux demi-bateaux
sont mis au sec pour être réunis ; en une
dizaine de jours, l'Europa est ressoudée.
Paul Pinquet retrouve alors son canal et ses nombreux
maigres. Lorsqu'il s'échoue sur un hautfond et
que les 300 chevaux du moteur ne peuvent l'en dégager,
il téléphone à l'éclusier
d'amont, qui lâche un peu d'eau dans le bief pour
le libérer. Il lui arrive aussi de devoir démonter
la timonerie (le cabanage) pour franchir des ponts trop
bas. Rivé à la barre, parfois douze heures
d'affilée, le jeune couple parvient ainsi au port
de la Lune. Le périple, long de 1 400 kilomètres
et hérissé de 275 écluses, aura duré
un mois et demi.
Désormais, la Babette et l'Europa transportent
les céréales - surtout du maïs - de
la coopérative Terres du Sud, qui, avec ses quatre
sites de Bon-Encontre, Sérignac, Damazan et Meilhan,
assure aux deux péniches une quarantaine de rotations
par an. Le fait que cette entreprise ait misé sur
les transports multimodaux (rail, route, canal) est évidemment
porteur d'espoir. Si Paul Pinquet et son épouse
réussissent leur pari de vivre et naviguer au pays,
deux autres jeunes mariniers sont prêts à
se lancer dans l'aventure.
Marie Gautier, le Chasse-marée,
N°136,
Un
monument majeur sur le Lot
Grâce à une politique dynamique de développement
dans le cadre d'un plan État-Région, le
succès du Lot ne cesse de s'amplifier au fil des
ans (hausse de fréquentation 65 % de 1999 à
2000). Voir reliés
Les deux tronçons actuellement navigables sont
le rêve de nombreux fluviophiles, il va commencer
à se concrétiser avec l'ouverture en juillet
de la grande écluse de Pontous, à Villeneuve-sur-Lot,
ouvrant le Lot jusqu'à Lustrac, 15 km en amont.
Depuis 1995, 'équipement de la rivière ci
permis de franchir d'importants dénivelés.
Ainsi le barrage EDF de Castelmoron fut-il équipé
cette année-là d'une écluse de 10
m, dont la réalisation avait été
confiée par le Conseil général du
Lot-et-Garonne aux entreprises Pétrissons, Dodin
et Soletanche-Bacwy. Les mêmes achèvent actuellement
la nouvelle écluse de Pontous qui, avec 13 m, devient
la plus haute des écluses à petit gabarit
(32,50 m x 5,20). Elle rattrape la chute d'un barrage
EDF et de sa centrale, construits il y a une quarantaine
d'années. Faire sauter ce gros verrou coûtera
800 MF pour l'ensemble, avec chenaux d'accès et
maison de service, dont 80 pour l'écluse seule
équipée de tunnels de fuite, larrons, bollards
flottants, automatisme... Fonctionnelles, les parois moulées
et profilées en courbe des canalets d'accès
ne manquent pas d'esthétisme. Il restera à
draguer le chenal jusqu'à l'ancien moulin de Gajac,
dont la chaussée sera arasée.
Cet ouvrage devrait rapidement devenir un monument majeur
du
réseau fluvial, une curiosité que l'on viendra
admirer de loin.
Marie
Gautier, Fluvial, Juillet-Août 2001
Terre
de rivières
Créée en 1994 par les trois
communes girondines de Langoiran, Le Tourne et Cadaujac,
l'association Terre de rivières, terre de Garonne
s'est donné
pour objectif de protéger les voies d'eau et de
développer l'animation autour du fleuve dans le
département. Durant quatre ans, les amoureux de
la Garonne se sont ainsi réunis à l'occasion
du salon régional Profluvia.. Depuis l’entreprise
a pris de l’extension, en France où plusieurs
départements et collectivités locales sont
désormais concernés, mais aussi en Pologne,
Hongrie, Portugal, en République Tchèque,
en Espagne.
Du coup, l'association girondine est amenée à
jouer lé rôle d'une fédération
internationale auprès du Conseil de l'Europe, pour
la défense de projets et la recherche de subventions.
Pôle d'information, de rencontres et de médiation,
Terre de rivières, terre de Garonne qui se veut
surtout un catalyseur d'énergies, propose aussi
à ses différents partenaires la signature
d'une charte pour la protection et la valorisation touristique
du patrimoine fluvial et rural. Tout projet allant dans
ce sens, qu'il soit individuel ou collectif, y sera bien
accueilli.
Marie Gautier, Le Chasse-marée
N°142
Ecole de Tersac
47180 Meilhan-sur-Garonne
05 53 94 30 63
Navigation
fluviale
Le bonheur est dans la vallée
L'écluse de Villeneuve-sur-Lot rend
la rivière aux Villeneuvois.
Le Lot-et-Garonne n'a jamais aussi bien
porté son nom depuis les travaux pour l'équipement
de ses cours d'eau. Cette politique volontariste est soutenue
contre vents et courants par le Conseil général.
La nouvelle écluse permettra une remontée
de seize kilomètres supplémentaires jusqu'à
Lustrac. La navigation sur le Lot était tombée
en désuétude dans l'entre deux guerres.
Mais de -nos jours, ce n'est plus d'un travail pénible,
celui des gabariers d'antan, mais de plaisir qu'il s'agit.
La remise en navigation du Lot, plus gros projet rural
d'aménagement concerté en France, provoque
une forte motivation pour attirer une clientèle
(allemande, anglaise et suisse) ; l'accent est mis sur
la qualité paysagère, l'entretien de la
rivière et des berges, ce qui permet aussi de créer
des emplois. Pour permettre aux touristes de se situer,
une charte graphique vient d'aménager une signalétique
homogène. Et des activités complémentaires
leur sont proposées : gastronomie, visite du musée
du pruneau ou du jardin de Latour Marliac ainsi que des
vélosroutes.
Le guide du navigant de John Riddel permet de franchir
sans appréhension
l'écluse de Castelmoron, qui atteint dix mètres
de hauteur.
Un quart des bateaux appartient à des particuliers.
Les estivants séjournent en moyenne trois jours
et demi avant la découverte du canal de la Garonne
et de la Baïse. L'ancien moulin de Gajac, transformé
en musée, expose l'histoire des eaux volantes,
eaux marchandes. Des bateaux électriques peuvent
être loués de juin à septembre.
Des barques de pêche sont amarrées sur la
rive gauche au droit des maisons des remparts, l'un des
lieux les plus charmants de Villeneuve sur un parcellaire
médiéval. La cale de la marine, récemment
réaménagée est redevenue un lieu
de vie qui regroupe les habitants et les navigants.
L'ouverture de l'écluse rend à Villeneuve-sur-Lot
sa rivière.
Ces travaux qui s'achèvent sont une inattendue
démarche de pèlerin qui
retrouve la route de Vèzelay vers SaintJacques-de-Compostelle.
Le projet ultime est de relier deux abbayes : Flaran sur
la Baïse et Conques sur le Lot. Un pas en avant consacré
!
Marie gautier
Octibre 2001, dans Confluent N°47